Avant toute chose, il
est essentiel de se remémorer les circonstances historiques qui ont présidé
à la construction puis au peuplement de nos cités et de nos banlieues.
Trois facteurs essentiels vont transformer l'image de la France : l'exode
rural, le recours à l’immigration, la reprise de la natalité ou baby
boom.
Après la guerre de 39-45 :
la France
doit se reconstruire. Le secteur industriel se développe très rapidement
notamment dans l'électro-ménager, l'aéronautique et la construction automobile,
contribuant ainsi à la croissance économique du pays. Les usines s'installent
près des villes.
Pas assez de main d’oeuvre.
Si
la fin de la guerre, le retour de la croissance, entraînent une reprise
de la natalité, pour l’heure, la population active n'est pas encore
assez nombreuse malgré une importante exode rurale. En effet, une mécanisation
intense des moyens de production agricole va entraîner une baisse d'emploi
dans ce secteur. Ainsi, les villages disparaissent, et les paysans quittent
les campagnes pour s'installer dans les villes ou dans leurs environs
immédiats. Leur nombre va diminuer de moitié entre 45 et 62. Mais la main
d'œuvre reste malgré tout insuffisante. La France va devoir faire
appel aux travailleurs de son empire colonial et de certains pays européens
(Pologne, Italie, Espagne). Dans les années 60, elle élargit son cercle
de recrutement à l'Europe méditerranéenne et aux pays récemment décolonisés
d'Afrique du nord et d'Afrique noire. Ce n’est qu’en 1974, que
le gouvernement limitera l'immigration.
Notre pays a connu une profonde mutation.
Si dans les années 1945, près de la moitié de la population vivait à la
campagne, dans les années 70, les trois quarts des français vont habiter
en ville. La France rurale et agricole est devenue une France urbaine
et industrielle.
Intensification
de la crise du logement.
 Les villes vont enregistrer une très
forte croissance. L’augmentation et le rajeunissement de la population
vont encore accentuer une crise du logement déjà bien implantée. A partir
de 1950, la priorité sera à la construction massive. Pour soulager les
grandes métropoles, répondre aux besoins d’habitat, les pouvoirs
publics développent l’urbanisation des banlieues. Les collectivités
locales voire départementales aidées par l'état construisent alors de
grands ensembles à la va vite mais sans chercher à humaniser ces nouveaux
espaces de vie, ni penser à construire des villes accueillantes. Ainsi
vont naître par exemple, Sarcelles dans le Val d'Oise, les Minguettes
à Lyon.
Les villes vont enregistrer une très
forte croissance. L’augmentation et le rajeunissement de la population
vont encore accentuer une crise du logement déjà bien implantée. A partir
de 1950, la priorité sera à la construction massive. Pour soulager les
grandes métropoles, répondre aux besoins d’habitat, les pouvoirs
publics développent l’urbanisation des banlieues. Les collectivités
locales voire départementales aidées par l'état construisent alors de
grands ensembles à la va vite mais sans chercher à humaniser ces nouveaux
espaces de vie, ni penser à construire des villes accueillantes. Ainsi
vont naître par exemple, Sarcelles dans le Val d'Oise, les Minguettes
à Lyon.
L'essentiel
de la construction s’est faite à proximité immédiate des
grandes villes. Mais ces nouveaux bâtiments sont construits un peu trop
rapidement. Ils sont constitués de blocs de béton, séparés par des terrains
vagues baptisés " espaces verts " . Ces derniers seront d’ailleurs
remplacés progressivement par des parkings suite à l’accroissement
de la vente automobile. Ces cités réalisées sans planification à long
terme, ont remplacé les taudis et les bidonvilles. Et si elles offrent
l'avantage d'un relatif confort moderne, elles sont toutefois, mal pensées
et bien peu aménagées.
Protection
des centres villes.
Dans les années 70, si
l’on assiste à une stagnation de la croissance des grandes
villes, il n’en ira pas de même pour les villes moyennes et
les banlieues où le prix du terrain est moins cher. Avec la "
sarcellite " ou le mal des grands ensembles, des voix commencent
à s’élever. La crise de la construction se double alors
d'une crise idéologique. Ainsi, on remet en cause les modes d'urbanisation,
en insistant désormais sur une construction qualitative et non
plus quantitative. Petit à petit, les architectes, urbanistes,
responsables politiques découvrent la valeur ajoutée que
peuvent procurer la préservation d'une structure urbaine traditionnelle,
la protection de l’aspect des paysages urbains anciens et des vieux
quartiers chargés d'histoire permettant une véritable implication
du citadin avec sa ville.
Un Plan de construction est lancé en 1971.
Il comporte
des thèmes nouveaux : innovation et écologie. Ainsi, va
être instaurée une politique de protection et de mise en
valeur mais axée principalement sur le centre ville. (réhabilitation,
transformation de certains quartiers en secteurs piétonniers permettant
de redonner la rue aux habitants et aux flâneurs). Ces réalisations
furent certes très utiles mais eurent un grand inconvénient
: leur coût élevé entraîna la disparition des
logements modestes et des petits commerces au profit de bureaux, de magasins
de prestige et d'appartements de standing. Petit à petit, nombre
de quartiers réhabilités ont été vidés
de leurs anciens habitants.
Laxisme dans la politique
d’urbanisation.
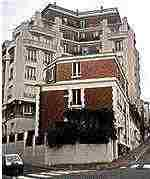 La politique de la protection du centre ville s’est accompagnée
en contrepartie d’un étrange laxisme en matière d'urbanisation
des quartiers périphériques et des banlieues. Les campagnes
proches vont être à leur tour urbanisées jusqu’à
ce qu’un coup de frein soit donné à ces grandes opérations
immobilières. Mais malheureusement, dans ces quartiers constitués
par des blocs de béton, le mal est déjà enraciné
profondément : laideur, uniformité, manque chronique d'équipement,
aucun centre commercial, pas ou peu de transport public, absence de cinéma,
d'équipement sportif digne de ce nom. Les entreprises susceptibles
de fournir des emplois font elles aussi, largement défauts. Dès
l'origine, les habitants qui emménagent dans ces quartiers ne vont
guère manifester d'attachement à leurs nouveaux lieux de
vie qu'ils considèrent plutôt comme des dortoirs tout à
fait provisoires.
La politique de la protection du centre ville s’est accompagnée
en contrepartie d’un étrange laxisme en matière d'urbanisation
des quartiers périphériques et des banlieues. Les campagnes
proches vont être à leur tour urbanisées jusqu’à
ce qu’un coup de frein soit donné à ces grandes opérations
immobilières. Mais malheureusement, dans ces quartiers constitués
par des blocs de béton, le mal est déjà enraciné
profondément : laideur, uniformité, manque chronique d'équipement,
aucun centre commercial, pas ou peu de transport public, absence de cinéma,
d'équipement sportif digne de ce nom. Les entreprises susceptibles
de fournir des emplois font elles aussi, largement défauts. Dès
l'origine, les habitants qui emménagent dans ces quartiers ne vont
guère manifester d'attachement à leurs nouveaux lieux de
vie qu'ils considèrent plutôt comme des dortoirs tout à
fait provisoires.
De 1945 à 1975, la France va donc connaître une véritable
mutation de sa population et de son cadre de vie : croissance urbaine,
création de grands ensembles, extension des banlieues, déclin
des villages, désertification des campagnes. Mais ces mutations
ne vont pas être accompagnées d’une politique d’urbanisation
planifiée et maîtrisée. Les nouveaux arrivés
vont alors s’entasser dans des cités peu humaines.Trois français
sur quatre vont désormais habiter en ville ou en banlieue.
Une nouvelle pauvreté
à l’écart des villes.
Ces grands ensembles furent édifiés pour accueillir toutes
ces nouvelles populations constituées en majorité de paysans
devenus ouvriers ou employés de bureau, et de la main d'œuvre
immigrée. Toutes ces classes populaires de 45 à 75, s'entassent
dans les HLM des banlieues dortoirs construits pour la circonstance.
Mais ils recevront également, les habitants dont les ressources
ne sont pas assez suffisantes pour espérer pouvoir se loger au
sein des résidences nouvelles et plus accueillantes résultant
de la politique de réhabilitation des centres villes.
Entre 71 et 75, c'est la crise. Certains secteurs de l'économie
s'essoufflent par exemple les mines, le textile. Avec l’accroissement
considérable du chômage, l'écart social se creuse
un peu plus. Une nouvelle pauvreté est en train de se développer
et certaines catégories sociales sont plus touchées : les
mères célibataires, les jeunes de moins de 25 ans, les travailleurs
non qualifiés, les plus de 50 ans, et les immigrés. Une
société a deux vitesses s'installe et c’est en priorité,
parmi la population vivant en banlieue que la crise va frapper durement
et durablement.
Conclusion.
De 1950 à 1981, un cinquième
de la France a été urbanisé avec pour résultat
un habitat parfaitement inadapté aux besoins de la population.
De 1981 à 1986, il y eut un manque évident de travail et
de réflexion sur des banlieues fortement sinistrées par
le chômage. La crise économique amplifia ce phénomène
d’’isolement des cités et l’on peut déplorer
qu'aucune politique de mixité sociale n’ait été
instaurée. Dans ces quartiers, les quelques dynamitages et remises
à neuf de cages à lapin sont un remède tout à
fait dérisoire face à l'ampleur du mal qui s'est installé,
et elles ne vont certainement pas remédier à la désastreuse
séparation qui existe entre les centres villes et les cités.
Ces dernières abritant des familles cumulant tous les handicaps
sociaux bien connus : chômage, exclusion sociale et difficulté
de logement.

